Entretien avec Jean-Marie Rouart, de l’Académie française.
« Ce qui me passionne dans mes personnages, c’est le thème de la destinée »
HL. Nous aurons l’honneur de vous accueillir le 21 novembre prochain à l’Hôtel Littéraire Le Swann pour la présentation de votre nouveau livre, « Les Aventuriers du pouvoir. De Morny à Macron » qui paraît dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur cet ouvrage ?
JMR. La collection Bouquins est une collection très prestigieuse et je ne boude pas mon plaisir d’en faire partie car elle réunit des écrivains et ce qui m’intéresse moi, c’est la littérature. Il y a des gens qui écrivent pour faire des best-seller ou pour séduire les dames – ça n’est pas contradictoire d’ailleurs. Je souhaite me situer dans une lignée littéraire. Des gens qui ont choisi de s’exprimer avec du style et le souci de faire passer l’esprit. Je suis très heureux d’appartenir à cette collection archi-littéraire qui réunit tous les écrivains que j’aime, un peu comme la Pléiade.
Je ne suis pas un historien et je ne prétends pas l’être. J’ai un regard d’écrivain sur l’histoire comme cela se faisait autrefois. Aujourd’hui, ce sont des universitaires qui font des biographies extraordinairement documentées, ce qu’on appelle maintenant la biographie à l’américaine ; c’est-à-dire qu’on ne vous passe rien dans la vie d’un écrivain, vous avez tous les détails. Celui qui a lancé la mode c’était Painter qui avait fait une vie de Proust, fameuse, saluée par Jean-François Revel : « On ne peut pas comprendre Proust si on n’a pas lu la vie de Painter ». Ce qui était à mon avis une erreur. On n’a pas besoin de Painter pour aimer Proust, ses livres suffisent. Ce qui n’empêche que c’est certainement l’auteur que j’aurais le plus aimé rencontrer.

HL. Pourriez-vous nous parler des trois biographies qui ouvrent le livre : Napoléon ou La destinée (2012), Morny, un voluptueux au pouvoir (1995) et Bernis, le cardinal des plaisirs (1998) ?
JMR. Ces trois biographies ne sont pas nées par hasard. Il ne s’agit pas de commandes d’éditeur mais des personnages avec lesquels je vivais, des mythes personnels. D’ailleurs, Jean d’Ormesson a fait un article dans le Figaro où il disait que je n’avais pas fait une biographie mais une autobiographie, que je m’étais identifié à Napoléon. Ce n’est pas faux, j’essayais de percer le secret de ce mystère : pourquoi on s’identifie à ce point à Napoléon. Il y a un phénomène d’identification qu’on ne trouve pas avec les autres personnages historiques ; très peu de gens se prennent pour le général de Gaulle, Louis XIV ou Jeanne d’Arc.
J’ai pris les choses sous l’angle de la faiblesse et de l’échec. Les historiens s’intéressent au succès et à ses détails, ils ne se rendent pas compte qu’une vie est faite de beaucoup plus d’échecs – regardez la vie du général de Gaulle, de Napoléon, de Churchill ou d’Abraham Lincoln. Les historiens préfèrent masquer les échecs. Prenez l’exemple de la tentative de suicide de Napoléon. Dans le Dictionnaire Napoléon de Jean Tulard, qui est pourtant un grand spécialiste, elle est mise au conditionnel. Alors que c’est une certitude : Caulaincourt est présent, on a la description des vomissements de Napoléon, ce n’est pas une invention. Mais cela ne rentre pas dans l’image qu’on veut avoir de Napoléon.
J’ai pris trois personnages avec lesquels j’avais des liens mystérieux, des liens de sympathie, comme si ça avait été des amis avec qui j’avais vécu autrefois. Avec Bernis, cela a correspondu avec mon désir de faire de la politique – j’aurais rêvé de faire de la politique mais je n’étais pas fait pour ça. J’ai retrouvé chez Bernis cet ambitieux gentil et sentimental. Pour le duc de Morny, l’aspect qui me passionnait, c’est que c’était un bâtard ; j’ai une passion pour les bâtards, parce que je trouve que ce sont des gens beaucoup plus intéressants. Ils ne sont pas insérés dans une famille, ils ont une sorte de liberté vis à vis d’elle et au fond, je pense que tous les artistes sont des bâtards. Il faut casser avec sa famille comme l’a fait Jean d’Ormesson en couchant avec la femme de son cousin. Pour être un artiste, il faut rompre les liens familiaux.
Ce sont tous trois des personnages très différents mais j’ai un lien mystérieux avec chacun qui correspond à une part de moi-même et que j’ai réussi à développer à travers eux. Il y a un peu de moi dans les trois.
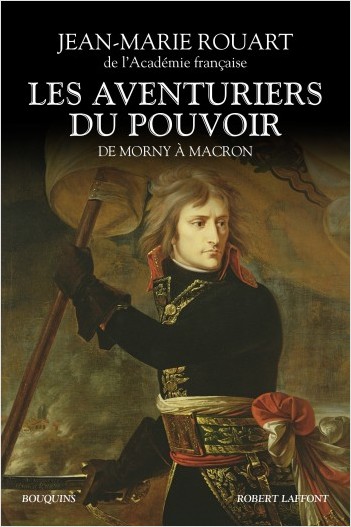
HL. Y a-t-il des points communs entre ces trois personnages ?
JMR. L’ambition, l’amour de la grandeur, l’esprit et l’amour de la France – la France comme une idée. Disons aussi une forme d’humanité et un grand appétit pour l’art et la culture. Napoléon emmène 17 000 volumes lorsqu’il part pour son expédition en Egypte ; c’est un fou de lecture, de littérature et il adore les écrivains, tout comme Morny et Bernis. Ce sont des hommes de culture, d’ambition mais en même temps d’amitié et de distance vis à vis du pouvoir. Ils ne se prennent pas au sérieux.
HL. L’amour des plaisirs a-t-il pu nuire à leur réussite politique, particulièrement en ce qui concerne Morny et Bernis ?
JMR. C’était de terribles dragueurs mais on était avant l’époque de #metoo. Bernis, bien qu’ecclésiastique, était un homme à femmes mais il a toujours montré beaucoup de dignité. Morny était un consommateur frénétique de femmes mais très gentil ; il a promu Sarah Bernhardt. C’était des amoureux. Napoléon a eu aussi beaucoup de liaisons mais c‘était sans doute le moins intéressé par les femmes ; et étrangement, c’était le plus malheureux, il a toujours été trompé.
Il n’y a pas chez Bernis l’acharnement au pouvoir de quelqu’un qui se croit indispensable à la France. Il y a une modestie, une gêne qui fait qu’il ne se sent pas indispensable alors que son rival Choiseul le croit. Quant à Morny, étrangement, il y a un certain dilettantisme du pouvoir. Alors que Napoléon n’est pas un dilettante du pouvoir ; le pouvoir est dans sa personnalité. Pour les deux autres, ce sont les femmes et surtout les amis qui jouent un très grand rôle.
HL. Votre livre contient une deuxième partie intitulée « Portraits acides » avec de nombreux inédits.
JMR. En effet, à ces trois biographies, j’ai décidé d’adjoindre des hommes politiques contemporains. Cela s’appelle « Portraits acides », depuis de Gaulle jusqu’à Macron. On tombe d’un cran car ces hommes ne sont plus dans la même société extrêmement raffinée, très littéraire et cultivée du XVIIIe puis du XIXe siècle. Mis à part de Gaulle, ce sont des hommes d’aujourd’hui.
HL. Sauf Mitterrand ?
JMR. Oui, il est celui avec lequel je me suis le mieux entendu même si c’est paradoxal. J’ai été très sévère – trop sévère d’ailleurs – avec Giscard d’Estaing. Etrangement, j’étais tout à fait d’accord avec sa politique mais pas avec l’homme et c’est l’inverse avec Mitterrand. Je n’étais pas du tout d’accord avec sa politique mais j’aimais beaucoup l’homme. Il m’a tout de suite écrit pour me voir, on s’est vu à Château-Chinon puis à l’Elysée, on avait du plaisir à se parler ; je crois qu’il m’aimait bien, avec ce que je représentait et le contexte culturel de ma famille.
J’essaie d’expliquer ma relation avec Giscard par la formation, c’est un polytechnicien, un positif ; on ne peut pas jouer avec Giscard. Mais c’est un homme très intelligent ; il était plein de qualités et il fut un très bon président dans des conditions difficiles, torpillé par son propre camp.

La littérature est jeu de vérité, il ne s’agit pas de mondanité. On peut être injuste. Croyez-vous que Chateaubriand n’est pas injuste avec Napoléon quand il dit qu’il est pire qu’Attila ? Alors qu’il lui avait été un courtisan quand il était jeune écrivain et qu’il publiait Le Génie du christianisme, dédié à Bonaparte. Et quand il entend Napoléon à Sainte-Hélène dire qu’il était un très grand écrivain, il redit du bien de Napoléon. Les écrivains sont comme les jolies femmes, ils sont sensibles aux autres ; il faut être conscient de cette subjectivité. Ce qu’on attend des écrivains c’est qu’ils disent ce qu’ils pensent. Pourquoi serait-on obligé d’être indulgent avec les hommes politiques ? Ils ont une responsabilité et les écrivains sont là comme un cinquième pouvoir pour les juger. Et les écrivains sont eux-mêmes jugés, comme tous les hommes publics.
HL. Avez-vous conçu ces portraits comme un exercice à la Jean Cau et ses Croquis de mémoire ?
JMR. Il n’y a pas seulement Jean Cau. Autrefois, tous les écrivains étaient impertinents comme Mauriac, Camus, Bernanos, Barrès, Constant. Il y avait des liens évidents entre le pouvoir politique et celui des écrivains en face, qui s’opposaient. Maintenant j’ai l’impression d’être un des derniers à être dans cette optique. Il y avait Jean d’Ormesson qui commentait la politique. Moi ça ne me gêne pas de temps en temps de dire des choses un peu sévères et d’être dans la vérité.
HL. Certains s’en sont-ils déjà offusqué ?
JMR. Oui mais c’est normal car en littérature je ne me suis jamais soucié des convenances. Les convenances qui sont la mort de la vérité. La politique c’est de l’histoire qui se fait. Ma passion pour le pouvoir est très ancienne ; j’ai commencé avec La blessure de Georges Aslo, puis Les Feux du pouvoir, qui a eu le prix Interallié, Avant-guerre et Devoir d’insolence. Comme le disait Balzac, « Je ne suis ni à droite ni à gauche, j’appartiens à cette opposition qui s’appelle la vie ».
Et dans la collection Bouquins, j’ai publié Les Romans de l’amour et du pouvoir qui reprend certains titres dont je vous ai parlé. Le pouvoir est associé à l’histoire mais aussi au bonheur ; les ambitieux rêvent du bonheur, de séduire les femmes. Ils pensent que toutes les questions de la vie vont se résoudre dans le pouvoir, alors que ça ne fait qu’accroître les difficultés ou en créer de nouvelles. Et comme j’ai été journaliste politique, je côtoyais ces hommes. Sarkozy m’a dit un jour : « Ah non, vous n’allez pas me poser des questions de journaliste. » Tous me voyaient comme un écrivain plutôt qu’un journaliste, pour que j’élève un peu le débat.
J’ai un lien mystérieux avec le journalisme ; un de mes livres s’appelle « Le psychodrame français », c’est un recueil d’articles. D’habitude cela n’intéresse personne de publier les articles des journaux mais là oui, car le regard d’un écrivain en politique est différend.
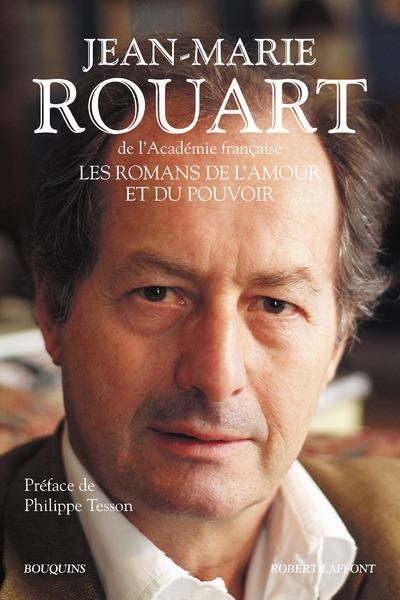
HL. Avec en plus le talent d’une plume d’écrivain ?
JMR. Certains journalistes écrivent très bien mais leur but n’est pas le même que celui d’un écrivain. Un écrivain porte l’esprit ; il a une vision, qui lui appartient en propre. Lamennais résumait cette idée ainsi : « Tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je voit. »
Mes articles pouvaient être moins bons d’un point de vue journalistique. Je n’ai pas ce qu’ont les journalistes mais ils n’ont pas non plus ce que j’ai. On est chacun dans des catégories différentes. Je relis par exemple Mauriac, ses Bloc-notes rédigés entre 1945 et 1970, c’est sensationnel. Un article de journaliste, ça a périt, c’est mort. A quoi tient qu’un texte d’écrivain dure ? Son talent mais aussi le fait que l’écrivain est une personne qui a une saveur, il a ses défauts et ses qualités. Le journaliste, qui est fait pour l’information, est absorbé par une fausse objectivité.
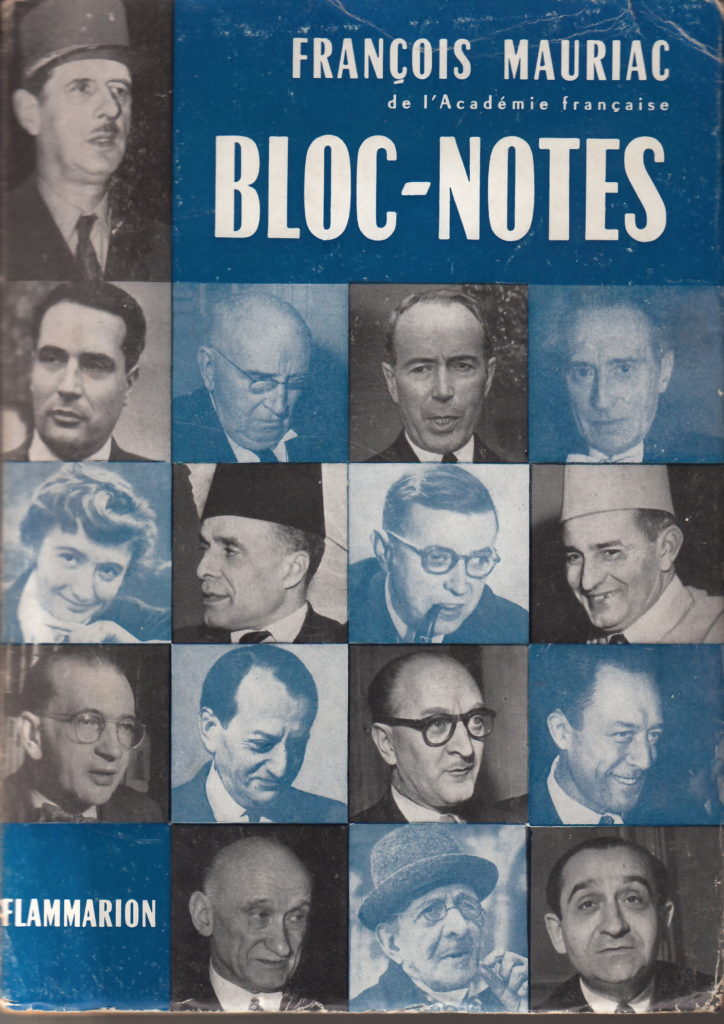
HL. Avez-vous des projets pour le roman ?
JMR. J’espère que non car je suis fondamentalement un romancier. C’est le roman qui m’a amené à la littérature, le désir de jouer avec ma vie et d’essayer par des histoires d’apporter aux autres une vérité. Un peu ce que faisait Jésus avec ses paraboles : arriver à transmettre l’esprit au moyen d’histoires. J’ai dû écrire douze ou treize romans, et ce sont des vrais romans. Il y a toujours une base personnelle. Dans ce livre là, non [en désignant La vérité sur la Comtesse Bernaiev]. Le roman fait partie de ma vie, j’ai vécu avec le désir de vivre des romans. L’amour a joué un grand rôle dans ma vie. Mais je ne sais pas si j’écrirai un nouveau roman ; c’est très mystérieux, il y a un moment où le romancier arrête d’écrire. Mauriac s’est arrêté à 55 ans ou 60 ans.
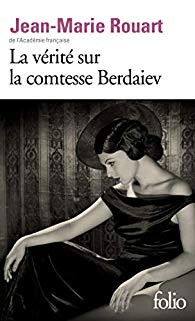
HL. C’est la grande saison des prix littéraires. Après le Grand Prix de l’Académie française, le Goncourt et le Renaudot ont été remis hier et le Femina cet après-midi. Avez-vous des commentaires sur les heureux élus ?
JMR. J’ai fait un entretien sur le sujet avec Bernard Pivot à l’Hôtel Littéraire Le Swann qui est paru cette semaine dans l’Express : « Duel de mots entre Académiciens ». Nous nous apprécions beaucoup avec Bernard Pivot, il y a une vieille connivence entre nous. A l’époque, son émission Apostrophe était un monument. Il a bien voulu m’inviter pour parler de mon livre sur Omar Raddad pour lequel je voulais un retentissement ; le seul moyen était que Bernard Pivot en parle.
Je pense que les prix littéraires sont utiles pour faire connaître des écrivains. Mais une fois sur deux, ils votent bien ou moins bien, comme tout le monde et comme l’Académie quand elle fait ses élections ; une fois sur deux elle peut se tromper. C’est le mystère de la destinée. Ce mot est important, c’est lui qui me fait écrire mes romans, mes biographies. Pourquoi certaines personnes ont-elles une destinée ? J’aime cette phrase du général de Gaulle : « Nous portons tous quelque chose de plus grand que nous-mêmes. »

Bernard Pivot et Jean-Marie Rouart, à l’Hôtel Littéraire Le Swann à Paris. Dialogue urbain autour de l’Académie Goncourt, de l’Académie française et de la vie littéraire.
Julien Daniel / MYOP pour L’Express.
HL. Vous êtes aussi un grand amoureux de Marcel Proust ?
JMR. J’ai une passion pour Marcel Proust. Je ne veux pas jouer au jeu de dire qu’il est le plus grand ; j’adore aussi Tolstoï qui n’a rien à voir avec Proust, j’aime beaucoup Céline et son Voyage au bout de la nuit. Mais il y a quelque chose de très complet chez Proust ; à la fois Valéry pour les belles phrases, Alexandre Dumas pour le mouvement romanesque, de l’humour, de la drôlerie, de la tristesse et en même temps un grand réconfort. Un grand réconfort parce qu’il a souffert et qu’il a réussi à en faire un antidote à la souffrance pour les autres. Moi quand j’étais plaqué par une dame, ce qui m’est arrivé très souvent, j’allais lire Albertine disparue qui commence par ces mots « Mademoiselle Albertine est partie ! ». Ça faisait du bien de se dire que ce qui m’arrivait à moi était aussi arrivé à un génie qui avait réussi à en tirer quelque chose. Le processus de s’identifier, c’est à ça que sert la littérature. Cela permet de se sublimer, de la même façon qu’une religion. A travers le martyre des saints, vous arrivez à oublier votre propre malheur. Les souffrances d’amoureux de Proust avaient un effet sur moi de consolation. Son livre est à la fois une autobiographie transformée en fiction et une fiction formidable. On y trouve aussi l’art du portrait ; il y a tout, c’est extrêmement complet. Ce que j’aime encore chez Proust c’est l’aspect des réminiscences ; quand on le lit on a des réminiscences de Saint-Simon, Balzac. C’est une lecture très ouverte.

HL. Avez-vous un autre favori parmi les écrivains de nos Hôtels Littéraires ?
JMR. J’adore Marcel Aymé, à la fois l’homme de théâtre avec La tête des autres et le nouvelliste. Mais aussi le romancier, Uranus est absolument sensationnel et très courageux.
Si j’avais été ministre de la Culture, j’aurais eu le projet de demander à toutes les villes régionales de mettre en valeur leur patrimoine, contrairement à cette ministre qui voulait apporter la Joconde dans toute la France. Ces villes ont souvent un équivalent ; le Musée de Nantes a le Portrait de Madame de Senonnes d’Ingres qui est un chef-d’œuvre. Le Musée de Pau possède Un bureau de coton à la Nouvelle Orléans de Degas qui est sensationnel.
Chaque région a un écrivain, elles devraient cultiver ce qui fait l’originalité de chaque province. Vous devriez faire un hôtel Paul-Jean Toulet dans le Béarn. Je suis très content d’être invité chez vous. C’est bien de faire entrer la littérature dans la vie.
 Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans. Edgar Degas. 1873. Musée des Beaux-Arts de Pau.
Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans. Edgar Degas. 1873. Musée des Beaux-Arts de Pau.
Propos recueillis par Hélène Montjean









