Les Éditions de Fallois ont publié en septembre 2020 un document inédit : la traduction des mémoires de Gertrude Tennant (1819-1918), Mes Souvenirs sur Hugo et Flaubert.
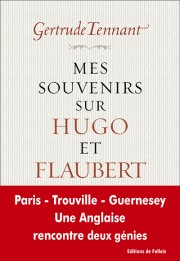
« Cette jeune Anglaise romantique, installée à Paris autour des années 1830, rencontra Victor Hugo déjà célèbre et sympathisa sur la plage de Trouville avec un inconnu nommé Gustave Flaubert.
Plus tard, elle continua à correspondre avec l’auteur de Madame Bovary et elle retrouva Victor Hugo à Guernesey en 1862, l’année du triomphe des Misérables.
De sa proximité avec ces deux génies témoignent ses lettres et les souvenirs écrits sur ses vieux jours, alors qu’elle recevait chaque semaine le Tout-Londres dans son salon.
Conservés dans une malle et un grenier, ils sont ici édités ensemble pour la première fois. »
Nous avons été à la rencontre de Florence Naugrette, traductrice, professeur de littérature française à Sorbonne Université et spécialiste de Victor Hugo
et d’Yvan Leclerc, co-éditeur du livre, professeur émérite à l’Université de Rouen et spécialiste de Gustave Flaubert.
Le livre sera présenté à l’Hôtel Littéraire Gustave Flaubert le mardi 21 septembre 2021 à 18h30.
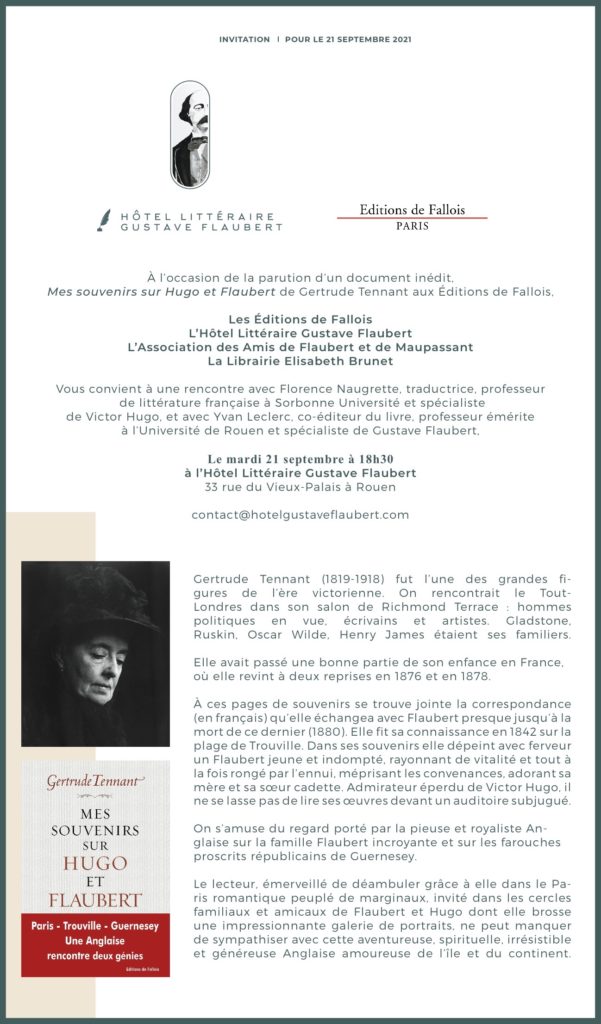
HL – Yvan, pouvez-nous raconter votre découverte des manuscrits et l’histoire de ce projet éditorial des souvenirs de Gertrude Tennant ?
YL – On connaissait l’existence d’un important dossier sur les sœurs Collier et Flaubert par un article de Philipp Spencer publié dans les Amis de Flaubert en 1954.
Mais il a fallu attendre la publication par David Waller d’une biographie de Gertrude Tennant (traduite sous le titre La vie extraordinaire de Mrs Tennant, figure littéraire de l’ère victorienne, Buchet Chastel, 2011) pour en apprendre un peu plus. C’est grâce à lui que j’ai pu entrer en contact avec l’arrière-petite fille de Gertrude Tennant, qui habite dans le Surrey, au sud-est de l’Angleterre.
Les manuscrits sont conservés là, dans une malle. Ce que j’ignorais à l’époque, c’est qu’il y avait également des pages importantes concernant Victor Hugo. D’où le projet de réunir dans un même volume les souvenirs de Gertrude sur les deux écrivains.
HM – Florence, pouvez-vous nous présenter la figure de Gertrude Tennant et son salon de Londres fréquenté par la meilleure société ?
FN – Gertrude Tennant (1819-1918) était la fille d’un officier de marine (Henry Collier) qui s’est retrouvé en demi-solde après les guerres napoléoniennes. Il est donc venu s’installer en France, où la vie était moins chère, avec sa famille. C’est ainsi que Gertrude, à cinq ans, arriva en France (à Honfleur d’abord, à Paris ensuite), où elle fut éduquée jusqu’à ce qu’elle reparte pour se marier en Angleterre l’année suivante (à 27 ans), avec un homme plus âgé qui la rendit très heureuse. Son mari était un homme d’affaires et un politicien libéral.
Elle se consacra à l’éducation de ses enfants (elle en eut 6 dont 2 moururent en bas âge), puis, la famille ayant déménagé dans un quartier huppé de Londres, elle entama à 51 ans une activité de salonnière qu’elle exerça pendant une quarantaine d’années.
Ses parents ne s’étaient pas intéressés à son éducation (on avait tendance à négliger l’éducation des filles à cette époque, mais elle s’était fait une culture d’autodidacte et adorait la littérature anglaise (pour le roman, surtout George Eliot, et aussi les poètes romantiques anglais, notamment Coleridge) et française (notamment Hugo).
Elle conçut son salon comme un endroit où faire se rencontrer les grands esprits de son temps appartenant à des domaines différents : écrivains (tels Oscar Wilde, Henry James, John Ruskin, Robert Browning), savants (le darwiniste Thomas Huxley), acteurs (John Irving, Coquelin aîné le créateur de Cyrano), peintres (Millais et Watts firent le portrait de ses filles), aventuriers (elle reçut Henry Stanley au retour de ses explorations en Afrique, et il devint son gendre), hommes politiques (le Premier ministre Gladstone, Lord Houghton qui servit d’intermédiaire pour mettre en contact Henry James et Flaubert).
Elle recevait aussi parfois plus de cent personnes pour de très grandes réceptions mondaines, dont le mariage de sa fille Dorothy avec Henry Stanley qui fut, en 1890, un grand événement mondain.

HL – Quelles furent les relations de Gertrude Tennant avec Flaubert, pour lequel elle éprouvait une affection toute particulière ?
YL – Il faut replacer ces relations dans le contexte social de cette époque : une jeune fille de bonne famille, en âge de se marier, gardait ses distances avec un jeune homme. Gertrude est attirée par ce beau garçon sauvage et romantique ; elle en fut peut-être amoureuse, si on prend au sérieux l’autofiction qu’elle a composée, en marge de ses souvenirs. Mais elle se trouve en rivalité avec sa sœur Henriette. Son éducation puritaine lui interdit une trop grande familiarité. Par exemple, Gertrude n’apprécie guère que Gustave l’appelle par son prénom (les jeunes gens se sont toujours vouvoyés). Et surtout, tous les membres de la famille Flaubert blessent sa piété par leur anticléricalisme militant.
HL – Quels furent ses rapports avec Victor Hugo, l’homme et son œuvre ?
FN – Elle découvrit d’abord Victor Hugo par son œuvre, à l’école, où l’on se battait entre « classistes » et « romantistes », comme elle dit, et où on lui donnait à apprendre des poèmes de Hugo.
Puis elle le rencontra, quand elle avait 17 ans, dans son salon de la Place Royale (actuelle place des Vosges où se trouve la Maison de Victor Hugo que l’on peut visiter – et où il y a en ce moment une magnifique exposition de ses dessins), à l’occasion de l’exposition d’un tableau que Hugo avait reçu du duc d’Orléans. C’est une cousine éloignée de Hugo, amie de classe de Gertrude, qui l’avait introduite.
Une autre fois elle fut secourue par Hugo en traversant un pont de Paris : il paya le droit de passage pour elle et discuta avec elle en la raccompagnant.
Puis Gertrude rencontra Flaubert qui n’était pas encore connu (ils avaient tous deux une vingtaine d’années) : il lui récita, sur la plage de Trouville, des vers de Hugo, et lui fit découvrir, à Paris, en 1843, Les Burgraves et leur préface.
Une vingtaine d’années plus tard, devenue épouse et mère de famille, elle le rencontra de nouveau à l’occasion d’une villégiature de quelques mois à Guernesey, en compagnie de son mari et de sa famille. C’était pendant l’été et l’automne 1862. Les Misérables venaient de paraître, elle les avait lus en français, et avait appelé les poupées de ses filles Cosette et Fantine. Grâce au professeur de français de ses enfants, qui leur donnait aussi, à elle et à son mari, des leçons de conversation, et qui était un ami très proche de Hugo (Kesler), elle put rencontrer Hugo, sa femme et sa fille, à Hauteville House, et les recevoir chez elle. Elle partagea avec eux un dîner chez des connaissances communes, et participa à des rencontres amicales et des discussions chez Hugo, avec ses invités habituels. Dans son témoignage, elle relate leurs discussions sur des sujets politiques (l’abolition de la misère), littéraires, sociétaux ou civilisationnels (la cuisine comparée de divers pays, l’obligation ou non de contraindre les domestiques à la pratique religieuse, l’apprentissage des langues étrangères, l’éducation des enfants), et brosse un portrait de première main de Hugo, sa femme et sa fille.
Elle fut de nouveau invitée chez Hugo en 1876, lors d’un séjour en France qui lui avait permis de revoir son vieil ami Flaubert. Mais curieusement, elle n’en parle pas.

HL – Aima-t-elle en Flaubert l’écrivain et comprit-elle son œuvre ?
YL – Gertrude Tennant est obligée de reconnaître le « talent » de son illustre ami (alors que Hugo a du « génie »), mais elle est choquée par le « réalisme » de ses œuvres et par leur crudité. La lettre qu’elle envoie après avoir lu Madame Bovary est restée célèbre : « Je ne comprends pas comment vous avez pu écrire tout cela ! – où il n’[y] a absolument rien de beau, ni de bon ! – et le jour viendra pour sûr, où vous verrez que j’ai raison. À quoi bon faire des révélations de tout ce qui est mesquin, et misérable : personne n’a pu lire ce livre sans se sentir plus malheureux et plus mauvais ! – Je ne sais quels sont les sentiments de votre mère, mais elle doit éprouver un chagrin mortel de voir un pareil ouvrage !… »
Pas rancunier, Flaubert lui a dédicacé ensuite Salammbô et Trois contes. Gertrude a dû préférer la Félicité d’Un cœur simple à Emma ! Mais on ne sait pas ce qu’elle a pensé de ces ouvrages : aucune lettre de remerciement n’a été retrouvée.
HL – Gertrude Tennant raconte ses souvenirs avec humour et talent, pouvez-vous nous conter quelques anecdotes ?
FN – Le charme de son écriture tient à sa capacité à changer de point de vue : catholique, elle admire Flaubert (athée) et Hugo (anticlérical) ; royaliste, elle s’intéresse au point de vue des Français républicains. Ce qui ne l’empêche pas de regarder les Français d’un œil amusé ou critique (sur le manque de curiosité de Hugo pour les langues vivantes alors qu’elle est elle-même bilingue, sur la paresse de Mme Hugo qui n’exerce aucune activité physique alors que Gertrude est bonne marcheuse, sur la frénésie républicaine et anticléricale de Kesler, admirateur passionné de Hugo).
Dans ses souvenirs du Paris post-révolutionnaire, qu’elle a connu sous la Restauration et la monarchie de Juillet, elle brosse aussi une galerie de portraits de marginaux fascinants : un violoneux qui se faisait appeler le marquis de Carabas, qui jouait et dansait au jardin des Tuileries ; une marchande de « plaisirs » (pâtisserie) tirée à quatre épingles, qui fascinait par sa noblesse et sa générosité envers les petits pauvres ; un homme érudit de leur voisinage dont les médecins découvrirent à sa mort que c’était une femme.
Sur Hugo et sa famille, elle raconte des choses qu’elle a vues ou que Kesler lui a racontées, qui font entrer dans son intimité : comment il a expliqué à la bonne du fils de Gertrude, qui ne voulait pas remettre ses chaussettes sur ses pieds mouillés à la plage, qu’elle devait la laisser faire à sa guise, et changer ses méthodes d’éducation ; à quel point Mme Hugo était triste et distante, toujours plongée dans le souvenir de sa fille morte, et toujours vêtue avec luxe, grand soin, et le plus grand mépris pour la mode anglaise ; les premiers signes de la folie de sa fille Adèle, que Gertrude repère à sa conversation obsessionnelle et à son comportement bizarre.
HL – Quel est l’intérêt de la correspondance entre Gertrude Tennant et Flaubert, en français, qui figure également dans le livre ?
YL – Il nous a paru utile de réunir à la fin du volume plusieurs dizaines de lettres échangées entre les quatre jeunes gens qui ont fait connaissance à Trouville en 1842, les deux sœurs Collier, Gustave et sa sœur Caroline. D’autres lettres de tiers concernent la mort de celle-ci, en 1846. Vous avez raison de souligner qu’elles sont en français : Gertrude parlait et écrivait bien notre langue, Henriette aussi sans doute, mais on n’a retrouvé aucune lettre d’elle. Les lettres de Gertrude sont toujours un peu mondaines, sur la réserve, cérémonieuses ; celles de Gustave sont plus pressantes quand il écrit à Henriette, tant qu’elle n’est pas mariée. Les lettres à Gertrude comportent souvent la formule d’une « inaltérable amitié » et elles montrent une grande mélancolie : pour Gustave, jusqu’à la fin de sa vie, les sœurs Collier sont associées à son passé heureux et à sa sœur disparue.

Seine Maritime (76), Le Havre, musée d’Art Moderne André Malraux (MUMA), « la plage à Trouville » de Eugène Boudin 1865
HL – Quelles nouveautés son témoignage apporte-t-il pour éclairer son époque et Victor Hugo en particulier ?
FN – Elle fait particulièrement ressortir les différences idéologiques et morales entre les sociétés anglaise et française, et la prégnance, en France, du souvenir de la Terreur trente ans après la Révolution française.
Elle nous montre Hugo hautain à Paris, hospitalier à Guernesey, impressionnant, courageux, idéaliste mais attentif aux réalités économiques, très bon avec les enfants, sportif, aimant la marche et le plein air.
Elle brosse son portrait physique : la dureté et l’éclat de son regard, la souplesse avec laquelle il se lovait sur son divan, l’autorité de sa parole.
Elle décrit sa stupeur à la découverte de l’ameublement et de la décoration de Hauteville House, où ne pénétrait pas la lumière du jour, et dont les galeries d’apparat lui paraissent décorées avec un goût invraisemblable, incompatible avec les canons anglais.
HL – Apporte-t-elle dans ses souvenirs un éclairage nouveau sur Flaubert ?
YL – Les souvenirs de Gertrude sont un document précieux, parce qu’à l’époque où elle rencontre Flaubert pour la première fois, il n’est évidemment pas connu, et nous n’avons pas de témoignage extérieur. Nous ne le connaissons que par ses lettres, donc par ce qu’il dit de lui-même. Là, il apparaît en actes, comme on l’imaginait : excentrique dans son habillement comme dans son comportement, en rupture avec les codes et les conventions. C’est déjà le Flaubert anti-bourgeois de la maturité. Il est solitaire, cassant, asocial, assez insupportable, il faut bien le dire, et, comme on le supposait, uniquement préoccupé par l’art, par la beauté des vers et de la prose. Ce qui est nouveau tient au diagnostic porté par Gertrude, qui doit s’y connaître en matière de spleen : « Personne ne mesure, je crois, à quel point il a souffert dans sa jeunesse de dépression nerveuse qu’il appelait ennui. »

HL – Ces Mémoires nécessitent-ils des rectifications historiques ?
FN – Oui, car tout n’est pas de première main, et elle tord parfois la réalité de manière avantageuse pour l’éclat de son récit.
D’une part elle a tendance à enjoliver les choses (quand elle raconte la vie de Juliette Drouet, telle que Kesler la lui a racontée, elle lui prête, ainsi qu’à sa fille, des talents artistiques qu’elles n’avaient pas) ou au contraire à les dramatiser à tort (elle prétend ainsi que Hugo n’avait pas apprécié le jeu de Juliette Drouet à l’époque où elle jouait dans ses pièces, alors qu’au contraire il l’avait félicitée).
D’autre part elle reprend certains clichés éculés sur Hugo qui font partie de la légende : sa mâchoire surpuissante, sa vue d’aigle…
Elle s’embrouille parfois dans les dates, comme lorsqu’elle dit avoir acheté Les Contemplations en France quand elle était à l’école dans les années 1830, alors que ce recueil date de 1856. Ou bien quand elle dit qu’à Guernesey, Kesler lui avait parlé de la mort de la fiancée de François-Victor Hugo (le fils), qui mourra en réalité en 1865.
Enfin, on repère que certains passages sont empruntés à des ouvrages postérieurs à leur rencontre de 1862 : le Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie (écrit par Mme Hugo et paru en 1863) ; Chez Victor Hugo par un passant (témoignage de Charles Hugo, le fils, sur la vie à Guernesey, paru en 1864) ; L’Archipel de la Manche (que Hugo a ajouté en 1883 à une réédition des Travailleurs de la mer) ; Choses vues, recueil d’anecdotes prises sur le vif et commentées par Hugo, paru à titre posthume en 1887.
Tous ces emprunts, ces erreurs, ces approximations, qui ne sont décelables que par un spécialiste, sont expliqués par nous en notes de bas de page. Cela permet de faire le tri entre l’authentique et la seconde main, entre la vérité et la légende.
Reste que tous ces souvenirs de Paris, Trouville et Guernesey sont une mine de témoignages précieux, de choses vues inédites, de conversations prises sur le vif, d’instantanés lumineux racontés avec esprit, talent et perspicacité, qui raviront le lecteur non seulement parce qu’ils lui feront découvrir Flaubert, Hugo et la société française vus par le regard original d’une Anglaise romantique, mais aussi parce que la personnalité enjouée, curieuse, sentimentale et spirituelle de Gertrude Tennant est très attachante.
Propos recueillis par Hélène Montjean







