Pour son édition 2020, le prix de l’Académie des Littératures 1900-1950 récompense deux livres : Le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel d’Olivier Weber (Éditions Plon) et Louise de Vilmorin. Vie de bohème de Geneviève Haroche-Bouzinac (Éditions Flammarion).
La remise du prix n’a pas pu avoir lieu comme chaque année dans les salons de l’Hôtel Littéraire Le Swann en raison du contexte sanitaire.
Voici la transcription du discours préparé par Anne Struve-Debeaux pour féliciter les deux lauréats :
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Le comité de l’Académie des littératures 1900-1950 a décerné, pour cette année 2020, deux prix : l’un à Madame Geneviève Haroche-Bouzinac, professeur de l’université d’Orléans, pour sa biographie Louise de Vilmorin. Une vie de bohème ; et l’autre à Monsieur Olivier Weber, écrivain et reporter, pour le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel.
Des ouvrages remarquables, qui ont un style et un contenu absolument maîtrisés, captivants et d’une rare perfection, et qui, en même temps, marquent aussi l’anniversaire de la disparition de ces deux écrivains : entre le cinquantième de la mort de Louise de Vilmorin et le quarantième de celle de Joseph Kessel.

DISCOURS POUR LA REMISE DU PRIX 2020 DE L’ACADEMIE DES LITTERATURES 1900-1950
À GENEVIÈVE HAROCHE-BOUZINAC
Regardons d’abord la biographie de Louise de Vilmorin rédigée par Geneviève Haroche-Bouzinac et publiée aux éditions Flammarion.
Une biographie saisissante qui retrace l’ensemble du destin de cette femme de lettres, entre son existence personnelle et sa carrière littéraire, en nous montrant, à travers les détours de l’univers qui ont été en elle, une femme sublime, séduisante, enchanteresse, éclatante de beauté et d’intelligence, mais qui, en réalité, pouvait aussi avoir de nombreux abîmes se déployant dans le labyrinthe inextricable de son inconscient.
Il est vrai que lorsque nous observons des photographies de Louise de Vilmorin ou que nous entendons sa voix sur une radio ou sur un poste de télévision, nous voyons, généralement, une femme brillante, ravie de bonheur et pleine d’entrain — un peu comme le trèfle à quatre feuilles qu’elle dessinait régulièrement dans sa correspondance, ses pièces dactylographiées ou manuscrites, ou les dédicaces placées dans ses livres.
Un trèfle qu’elle remplissait souvent de signes d’amitié, de chance ou d’espérance, mais qui pouvait peut-être cacher d’obscurs secrets, dans des lieux clos d’une âme profonde et ébranlée – un peu comme ce trèfle de cette vieille légende chrétienne qui relatait que, juste avant de quitter l’Eden, Eve avait pris celui-ci afin qu’il lui rappelle la merveilleuse vie qu’elle n’aurait plus jamais.
Ce qui est certain, c’est que si Louise de Vilmorin pouvait être une femme heureuse, moderne, ensoleillée, il lui arrivait parfois de se sentir seule et isolée. Elle pouvait ressentir comme un manque de concordance entre les relations issues des autres et, en même temps, au tréfonds de son être, comme une souffrance ou de sombres vicissitudes.
Cela venait, sans doute, de sa propre émotivité, de son hypersensibilité qui s’accordait à une mélancolie et à une solitude. Mais aussi, probablement, de certains événements qu’elle avait vécus dans son existence et qui, avec leurs ombres troubles, avaient pris racine dans son cœur et dans sa vie.
Il y eut tout d’abord, dans son enfance et sa jeunesse, une mère qui, plutôt que ses enfants, préférait la vie mondaine et politique. Puis alors qu’elle avait quinze ans arriva le décès de son père — un père qu’elle aimait beaucoup parce qu’il était généreux et s’alliait toujours à elle, même quand il était en voyage ; et ensuite, l’année suivante, ce fut elle qui attrapa une maladie : une tuberculose osseuse qui la frappa à une hanche, et qu’elle dut soigner durant trois ans, souvent allongée sur un lit ou dans un siège.
Sans compter, évidemment, ses deux mariages qui, eux aussi, se sont révélés être des échecs. Le premier, où elle épousa un Américain, Henry Leigh-Hunt, qui était un descendant du poète James Leigh-Hunt, et à l’issue duquel, après que leur divorce fut accompli, elle ne put généralement plus voir ses trois filles, parce que celles-ci étaient, la plupart du temps, aux Etats-Unis. Et le second mariage où, même si elle eut quelques années heureuses, elle dut de nouveau divorcer parce que le comte PaulPálffy d’Erdod, qui était hongrois, et qui s’était déjà marié à quatre épouses, se liait à des maîtresses, tout comme elle à ses amants.
Reste que, à travers ces déboires, ces désillusions, ces ténèbres qui traversaient son existence, Louise de Vilmorin, cependant, continuait de combattre ceux-ci. Elle voulait sortir de ce grave tunnel, avec une rage de vivre, afin de trouver une nouvelle inspiration et de croiser, sur le sens de la vie, toutes ces incertitudes.
Ce qui fait que, en elle-même, se trouvaient souvent des cheminements doubles, qui pouvaient être à la fois sombres et joyeux, telle la devise « Au secours ! » qu’elle concrétisait souvent, en éclatant toujours d’un rire joyeux.
Et l’on comprend aussi pourquoi, même si elle aimait Antoine de Saint-Exupéry, elle préféra ne pas l’épouser. Elle devait sentir que tous les deux, d’une certaine manière, avait le même caractère, le même penchant, et que cet aviateur, même s’il était fasciné par l’atmosphère céleste, les nues et le cosmos, ne pourrait lui donner tout ce qu’elle voulait, c’est-à-dire le septième ciel.
Un septième ciel qui, pour elle, était la société artistique, culturelle et mondaine.
Dès sa jeunesse, elle commença à lire des livres — des contes et des romans souvent rédigés par Charles Perrault, les frères Grimm, Hans-Christian Andersen ou la comtesse de Ségur. Puis, autour de vingt ans, après qu’elle eut épousé Henry Leigh-Hunt, elle se mit à dessiner, à peindre et à jouer de la guitare ; et, très vite, elle se consacra à des cercles mondains, où se retrouvait toute l’intelligentsia du temps — une intelligentsia qui pouvait venir de la France, mais aussi d’autres pays, comme l’Angleterre, l’Italie et bien d’autres ; et qui souvent se réunissait dans les demeures issues de Marie-Laure de Noailles, de Marie-Blanche et de Jean de Polignac, de Diana et Alfred Duff Copper, de Marie-Hélène et Guy de Rothschild, d’Elisabeth Chavchavadze ou d’Etienne de Beaumont. Et ensuite, après qu’elle eut rénové, autour de 1952, le château où habitait sa famille, situé à Verrières-le-Buisson, ce fut elle qui associa également cette haute société.
Dans ces salons prestigieux se liaient régulièrement de nombreux artistes et gens de lettres. Il pouvait y avoir des écrivains tels que Jean Cocteau, André Malraux, Saint-John Perse, Antoine de Saint-Exupéry et bien d’autres ; des compositeurs comme Francis Poulenc, Nadia Boulanger, qui était aussi pianiste et chef d’orchestre, ou Arthur Honegger ; ou encore des peintres tels que Jean Hugo, Marx Ernst, Marie Laurencin ou Emile Chambon,. Et bien sûr, plusieurs autres personnes comme les éditeurs Gaston Gallimard ou Pierre Seghers ou des acteurs comme Orson Welles ou Jean Marais…
Et, à travers toute cette vie mondaine, Louise de Vilmorin comprit, alors qu’elle était à la trentaine, et surtout grâce à l’encouragement d’André Malraux, qu’elle pourrait peut-être devenir une femme de lettres. Elle commença à rédiger trois œuvres : deux romans, Sainte-Unefois (1934) et La Fin des Villavide (1937), et un recueil de poèmes, Fiançailles pour rire (1939).
Puis, jusqu’à sa mort, elle continua à écrire d’autres ouvrages : Le Lit à colonnes (1941), adapté au cinéma par Roland Tual, Le Retour d’Erica (1947) qu’elle aimait beaucoup, Julietta (1951), réalisé par le cinéaste Marc Allégret, et Madame de (1951), par Max Ophuls. Et ensuite, d’autres récits comme La Lettre dans un taxi (1958), La Migraine (1959), ou encore des recueils poétiques comme Le Sable du Sablier (1945), L’Alphabet des aveux (1954), ou Poèmes (1970), qui pouvaient créer des palindromes, des holorimes ou des calligrammes…
Des œuvres qui, en réalité, tout comme la conscience qui était en elle-même, avaient une véritable et troublante confusion des sens, dans une certitude où se mêlaient régulièrement une incroyable splendeur et de sombres tourments, à travers une mélancolie et un idéal, un chagrin et une tendresse, une amertume et un bonheur — et qui souvent s’accordait à des consentements pouvant venir d’une vie mondaine ou de relations d’amour, toutes comme celles qui étaient issues de l’ auteur elle-même qui, dans toute sa vie, s’est toujours liée à elles et a toujours séduit de nombreux soupirants.
Et c’est pourquoi, dans toutes ses œuvres, on comprend, de fond en comble, toute l’existence de Louise de Vilmorin, à travers des sensations permanentes d’instabilités, où se dévoilent régulièrement des ambiguïtés et des oppositions – telles des eaux qui, même si elles sont tranquilles, peuvent se remuer, s’agiter et entrer en ébullition par des courants ondoyants et tortueux.
On y voit des divertissements, de la musique, des jeux, de la danse, ainsi que de véritables hymnes à l’amour, mais qui peuvent être aussi de véritables échecs ou de graves drames et, très souvent, impliquer pour certaines personnes une perte douloureuse ou une disparition — comme celle de Rémy Bonvent et de Clément Porey-Cave, dans Le Lit à colonnes ; d’Erica, qui se noie dans un étang ; de Louise et du baron Donati, dans Madame de… ; ou encore de ces amants dans ce poème issu du recueil Fiançailles pour rire :
La lune
Prenant l’amour à son image,
La lune brise au fil de l’eau
Les amants pris au fil de l’âge
Et leur indique les roseaux.
Les roseaux hantés de suicide
Et le dessein de belle mort
Fixé aux profondeurs liquides
Où se perd le plongeur de sort.
En fait, un peu comme des surgeons qui même s’ils se lient à des branches d’arbres élevés, issus de classes luxueuses, peuvent avoir des fatalités, des tempêtes, des cyclones, dans des moments à la fois subtils et sombres, où se forgent à la fois des larmes et des joies.
Ce que dit bien cette biographie de Geneviève d’Haroche-Bouzinac qui nous restitue tous les secrets de Louise de Vilmorin, à travers l’ensemble de cette femme de lettres, face à la vie qui a été la sienne.
Anne STRUVE-DEBEAUX
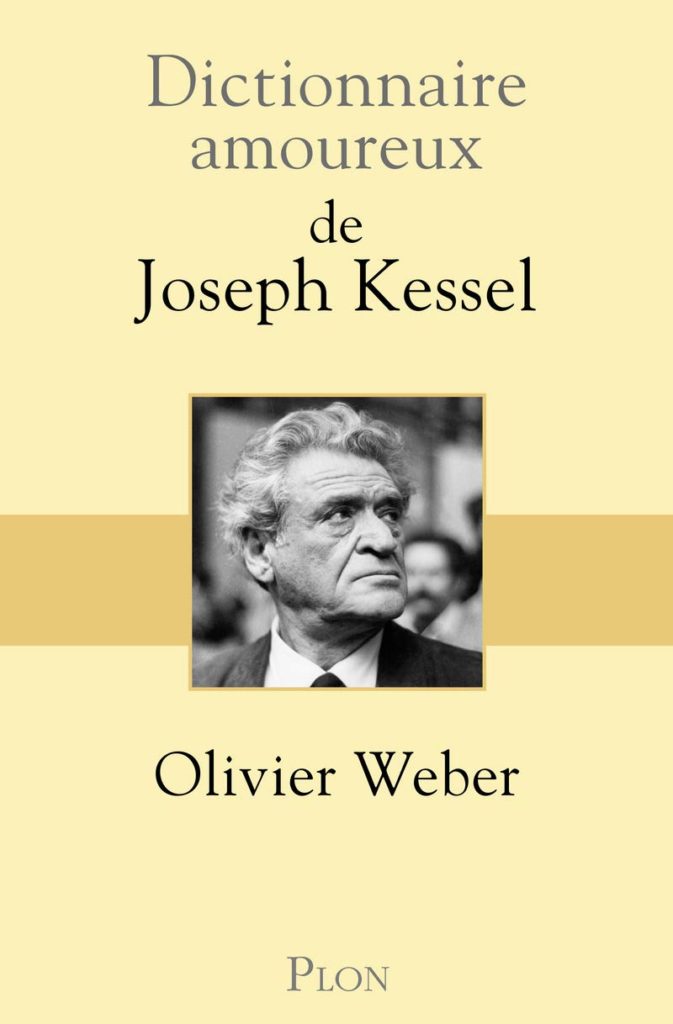
DISCOURS POUR LA REMISE DU PRIX 2020 DE L’ACADEMIE DES LITTERATURES 1900-1950
À OLIVIER WEBER
Et maintenant, nous allons regarder Le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel rédigé par Olivier Weber et paru aux éditions Plon, et qu’il faut absolument lire. Avec un talent et un style irréprochables de son auteur, et plus de mille pages, il permet d’appréhender tout ce qu’a vécu cet homme de lettres — un homme de lettres à la fois romancier, voyageur et grand reporter, tout comme Olivier Weber, ce qui fait que, en réalité, tous les deux se ressemblent de bien des manières, à travers leurs expériences, leurs rêves et leurs pensées.
Dans ce livre, on perçoit, tout d’abord, toutes les aventures que Joseph Kessel a connues dans les pays qu’il a traversés, entre l’Afghanistan, l’Amérique, la Syrie, l’Israël, la Russie, et bien d’autres… ; tous les voyages et toutes les expéditions, souvent mouvementés et hasardeux, qui, dans ces contrées inexplorées, lui montraient, telle une odyssée, l’ensemble du monde — un monde qui, en quelque sorte, était sa grande patrie.
On y voit aussi les guerres, qu’il a menées ou observées.
La Première Guerre mondiale, où il fut artilleur et aviateur, alors qu’il avait vingt ans; et la Seconde Guerre mondiale, où, s’engageant dans la Résistance et la France libre, il s’intégra dans l’escadrille Sussex de la RAF, afin d’épier les concentrations des ennemis, ou de lancer, en tant que bombardier, des projectiles.
Mais aussi d’autres guerres qu’il a examinées en tant que correspondant, dans des pays où, régulièrement, pouvaient éclater des affrontements, des combats ou des révolutions. Par exemple, l’insurrection à Vladivostok, en Sibérie, entre les Rouges et les Blancs, en hiver 1919 ; la guerre d’indépendance anglo-irlandaise où, en septembre 1920, il découvrit, dans le village Balbriggan, un véritable massacre, commis par les troupes spéciales des Blacks and Tans. Et bien sûr, la guerre d’Espagne, où, dans des villes anéanties et vides, il ne vit, en novembre 1938, que des civils et non des combattants : des hommes, des femmes, des enfants qui, impliqués dans ce désastre, devaient travailler ou former d’interminables files d’attente pour ne pas être assiégés par la famine ; et, lorsqu’il y avait des bombardements , se rendre dans des stations de métros ou des caves, qui étaient leurs abris de fortune.
Mais ce qui est certain, c’est que Joseph Kessel, dans toutes les expéditions qu’il a menées, et dans tous les conflits et les luttes violentes inhérentes aux rapports des forces qui s’opposaient entre elles, a toujours préféré regarder les êtres humains. Il s’associait à eux, fouillait leur vie en pleine mêlée, et la loi intime qui était en eux, tout simplement parce qu’il aimait s’intégrer à la communauté des hommes. Il se liait à celle-ci, avec une observation et un éclaircissement qui lui montraient, en réalité, l’ensemble des sources fondamentales de l’humanité.
Et c’est pourquoi, dans cet ouvrage, on découvre, également, de nombreuses personnes que Joseph Kessel a rencontrées – des personnes qui pouvaient être proches de lui ou plus lointaines.
Il y eut son frère cadet Lazare, dit Lola, qui se suicida à vingt-un ans — drame dont il ne s’est jamais remis. Mais aussi d’autres gens qu’il a aimés, comme Antoine de Saint-Exupéry , Emmanuel d’Astier de La Vigerie, journaliste, militaire et compagnon de la Libération, Jean Mermoz, dont il rédigea une biographie en 1938 après sa mort ; ou encore, son scénariste, André Berheim, qui était également compagnon de la Libération… Et, naturellement, certains écrivains, tels que Romain Gary, Jean Cocteau, Maurice Genevoix, ou son neveu Michel Druon, avec lequel il rédigea, en 1943, Le Chant des Partisans.
On y voit toutes les femmes qui ont été sa passion. Ses trois épouses : Nadia Politzu-Michunesti, qui venait de Roumanie et mourut très tôt ; Katia Gangardt, qui était née en Lettonie, et dont il divorça très vite ; et sa dernière femme, Michèle O’Brien, issue de l’Irlande. Et, bien sûr, plusieurs compagnes comme Lena, Sonia, ou Germaine Sablon…
Sans compter, évidemment, tous les êtres qu’il a vus, pressentis ou enquêtés dans ses missions et ses périples : les politiques, les diplomates, les humbles, les élites, les nantis, les faibles, les tyrans, les dictateurs ou les victimes…
Parce qu’il aimait le goût de l’humanité, Joseph Kessel s’est toujours allié à elle, ne s’isolant jamais des hommes, avec une vie qui n’était aucunement recluse. Il préférait s’accorder à la proximité de l’autre, avec un désir inébranlable d’aller à la rencontre d’autrui, en soudant son âme et son caractère.
Et l’on comprend, aussi, comment ses reportages et ses romans ont toujours été imprégnés à travers les souvenirs et les impressions qu’il a eus dans sa vie entière, dans un monde de réservoir à la fois inconnu et infini. Car, entre ses comptes-rendus qu’il rédigeait dans Paris-Soir, Le Matin, Journal des Débats, et bien d’autres quotidiens, et ses œuvres telles que L’Equipage, Belle de jour, La Passante du Sans-Souci, L’Armée des ombres, Le Lion ou encore Les Cavaliers, Joseph Kessel a toujours apporté une part des perceptions et des pressentiments qu’il avait découverts, avec une observation patiente et en même temps tenace, se liant à la réalité qu’il avait sentie, vue ou entendue – une réalité qui, en même temps, s’imprégnait aussi de tout ce qui était hanté physiquement en lui, entre les sensations et l’imagination qui se trouvaient en son for intérieur.
Un for intérieur qui, parfois, pouvait se heurter à des données tragiques, dans des heures sombres, mais qui, malgré tout, à travers toutes ces souffrances, demeurait incapable de renoncer au bonheur. Car même s’il a eu de vraies tourmentes, des sensations obscures, ayant de longues ombres, les conséquences de celles-ci ne l’ont jamais fait reculer. Entre le bonheur et le malheur, Joseph Kessel n’a jamais voulu ni n’a pu réussir à opérer une élimination. Il s’associait à l’un comme à l’autre — à la douleur, à la misère, au sacrifice, au péril, mais aussi à l’émerveillement et à la splendeur.
Cela venait, sans doute, de ce qui se trouvait en lui-même, des intentions issues des chambres de son cœur – mais peut-être, aussi de la génération qui était la sienne : une génération qui, à travers les guerres, la Grande Dépression, les dictatures, a connu de véritables cataclysmes, mais qui, malgré tout, continuait de s’amuser, de s’extasier et d’éprouver le sublime.
Je pense, par exemple, à cette strophe, que tout le monde connaît, d’Aragon :
Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes
N’est-ce pas un sanglot de la déconvenue
Une corde brisée aux doigts du guitariste
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans les rêves ailleurs que dans les nues
Terre terre voici ses rades inconnues
Une strophe qui, tout en montrant la tristesse d’un homme, dit aussi que le bonheur peut venir de la vision du monde – un monde que Joseph Kessel a toujours regardé, à travers ses étendues, ses espaces, ses horizons mais aussi à travers les êtres humains qui s’y trouvaient — et, également, ses animaux.
Et c’est pourquoi, juste avant sa mort, alors qu’il regardait, dans sa maison d’Avernes, sur un poste de télévision, un documentaire concernant la spéléologie, il a dit à une amie qui était juste à côté de lui : « Regarde comme le monde est beau ! », avant de décéder tout simplement d’une rupture d’anévrisme — une rupture qui, d’une certaine façon, a été comme sa vie, pleine d’espoir.
Car si la vie de Joseph Kessel a eu des hauts et des bas, elle lui a donné, à cause des pays qu’il a connus, des personnes qu’il a rencontrées, de sa passion pour l’humanité, et, bien sûr, de son écriture si pleine d’âme, finalement une vraie source éternelle de bonheur.
Anne STRUVE-DEBEAUX


