Discours de réception de Mario Vargas Llosa à l’Académie française :
« Flaubert est un immense écrivain, peut-être le plus important du XIXe siècle européen ».

Élu en novembre 2021 au fauteuil de Michel Serres, l’écrivain hispano-péruvien a été reçu sous la Coupole le jeudi 9 février 2023 par Daniel Rondeau.
Prix Nobel de littérature en 2010, il est l’un des rares privilégiés à être entré de son vivant dans la « Pléiade », avec deux volumes rassemblant ses principaux romans.
Dans son discours de réception, il fait l’éloge de son prédécesseur Michel Serres, comme le veut l’usage, mais prend le temps de s’attarder sur son mentor, Gustave Flaubert, auquel il a consacré un essai important, L’orgie perpétuelle : Flaubert et «Madame Bovary» (Gallimard, 1978) : « Je savais désormais quel écrivain j’aurais aimé être et je savais dès lors et jusqu’à ma mort que je vivrais amoureux d’Emma Bovary. Elle allait être pour moi, à l’avenir, comme pour le Léon Dupuis de la première époque, « l’amoureuse de tous les romans, l’héroïne de tous les drames, la vague elle de tous les volumes de vers. »
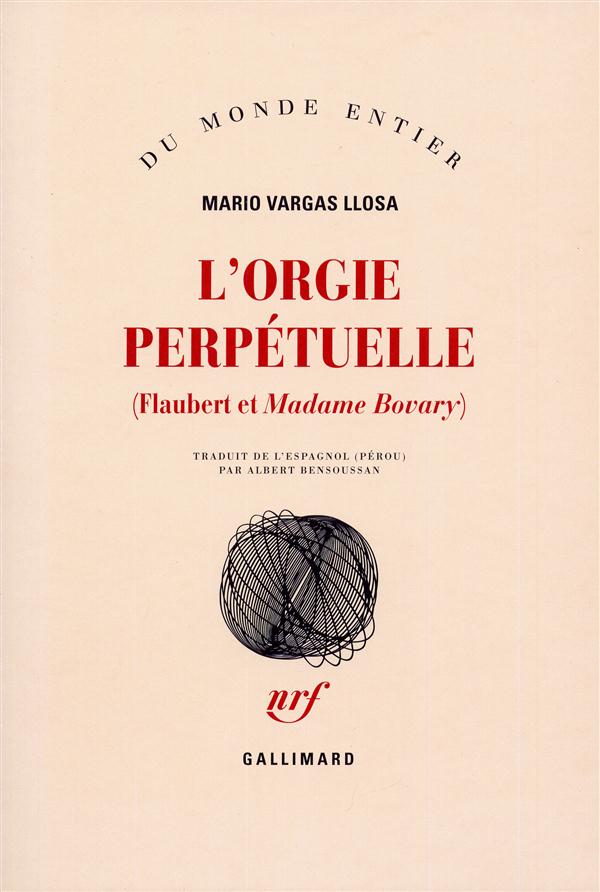
Le titre de son essai est tiré de la correspondance de Flaubert : « Le seul moyen de supporter l’existence, c’est de s’étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. » (Lettre de Flaubert à Mlle Leroyer de Chantepie, sept 1858).
Voici les extraits du discours qui rendent hommage à Flaubert :
« […] C’est, donc, à Paris que je suis devenu écrivain.
Mais le plus important, peut-être, c’est d’avoir découvert en France Gustave Flaubert, qui a été et sera toujours mon maître, depuis que j’ai acheté un exemplaire de Madame Bovary, le soir même de mon arrivée, dans une librairie aujourd’hui disparue, du Quartier latin, qui s’appelait « La Joie de Lire ». Sans Flaubert, je n’aurais jamais été l’écrivain que je suis, ni n’aurais écrit ce que j’ai écrit et de quelle manière. Flaubert, je l’ai lu et relu maintes fois, avec une infinie gratitude, et je peux dire que c’est à cause de lui, ou plutôt grâce à lui, que vous me recevez aujourd’hui ici, ce dont je vous suis, de toute évidence, très reconnaissant.

[…]
Je voudrais maintenant revenir à Gustave Flaubert et à la littérature française ; et vous dire comment le solitaire de Croisset m’a aidé à devenir l’écrivain que je suis. Le soir même de mon arrivée à Paris, en 1959, comme je l’ai dit, j’ai acheté un exemplaire de Madame Bovary à « La Joie de Lire », une librairie que je trouvais sympathique parce qu’on ne dénonçait jamais les voleurs de ses livres, ce qui explique qu’elle finirait par faire faillite. Je me rappelle aussi cette soirée à l’hôtel Wetter, au Quartier latin, où je logeais, et ce couple qui devint ami, les La Croix, comme un rêve dont je ne me suis jamais réveillé. Ébloui par l’élégance et la précision de l’écriture de Flaubert, je l’ai lu et relu en entier, de bout en bout, je veux dire que j’ai étudié ses romans et ses contes ainsi que sa correspondance, et j’ai fait le voyage à Croisset en déposant des fleurs sur sa tombe, pour le remercier de tout ce qu’il avait fait pour moi et pour le roman moderne.
Flaubert est un immense écrivain, peut-être le plus important du xixe siècle européen, ou du moins français, autrement dit mondial. Et son importance ne tient pas seulement à ses admirables romans – Madame Bovary et L’Éducation sentimentale, principalement –, mais à ses contributions à la structure du roman moderne, qu’il fonde d’une certaine manière, en aidant en chemin des écrivains adolescents – comme je le fus quand je l’ai lu pour la première fois – à découvrir leur véritable personnalité.
Je ne suis pas tout à fait sûr que Flaubert ait été pleinement conscient de la révolution qu’il nous a léguée avec son œuvre. Mais plus que les lectures à voix haute de chaque phrase – chaque mot – qu’il écrivait sur ce bout de terre qui existe encore et qu’il baptisa du nom de Gueuloir, ce qui me paraît important c’est l’invention du narrateur anonyme, ce Dieu – comme il le nomme – sur lequel se fonde le roman de nos jours. Ce narrateur invisible a permis de supprimer une foule de personnages qui encombraient le roman classique et qui étaient là simplement pour feindre qu’ils étaient les auteurs d’une histoire. Et il a permis au roman moderne de les sacrifier sans état d’âme – leur remplacement couvrant, dès lors, toutes les étapes du roman – et de faire un bond en avant qui a servi à tout le monde –, que le sachent ou l’ignorent les écrivains qui écrivent des romans. Nous lui devons tous quelque chose, et sans doute plus encore. Il fut une découverte peut-être plus importante que les recherches et acrobaties formelles de Joyce dans son Ulysse, qui ouvrit les portes de la modernité à la littérature. Mais je le répète, Flaubert ne fut pas tout à fait conscient de cette révolution qu’il mit en œuvre dans les cinq ans où il travailla à Madame Bovary, en s’inventant une longue maladie afin d’apaiser son bon chirurgien de père qui aspirait, bien sûr, à diriger son fils vers une profession libérale.
Ce narrateur invisible – qui est Dieu le Père, comme lui-même l’appela – n’a pas de raison d’être le seul narrateur ; un ou plusieurs personnages de l’histoire peuvent l’être aussi, à condition de ne pas savoir plus que les autres qui savent tout depuis leur position particulière, et d’alterner, comme ils le font dans Madame Bovary, dans L’Éducation sentimentale et dans les romans postérieurs qu’il écrivit. Tout le roman moderne est intimement affecté par cette découverte de Flaubert et c’est, dans doute, la plus importante incorporation de cette voix anonyme – celle de ce Dieu qui ne se laisse pas voir – dans les histoires que racontent ses contemporains. Sans le savoir, Flaubert, grâce à sa découverte du silencieux et invisible narrateur, a produit cette séparation entre le roman moderne et le roman classique, où il a rassemblé, sans le savoir ni le vouloir, une multitude d’œuvres qui, jusqu’alors, n’avaient pas remarqué que la présence du narrateur invisible réduisait extraordinairement la présence de narrateurs dans le récit. Ce fut la grande leçon de Flaubert ; sans compter naturellement, son application à travailler avec une ténacité fanatique, comme s’il en allait de sa vie, à la recherche de cette perfection qui transformait l’écrivain en une sorte de souffleur, de porte-voix de Dieu, ou même en Dieu.
Personne n’a conçu la littérature avec autant de rigueur et de dévouement. Et personne n’a écrit, comme lui, avec semblable patience et cette recherche obsédante d’un style parfait. Jusqu’à ce qu’à la fin, à travers ces deux copistes qui le représentent, Bouvard et Pécuchet, il se consacrât à écrire tout ce qui pouvait être écrit, entreprise impossible et délirante, condamnée à l’échec, bien entendu, mais un échec qui est à la taille des dieux, ou du moins relève de quelques dieux besogneux. C’est ce qui s’appelle mourir en visant au plus haut et donner à la littérature une apparence divine tout en foulant la croûte terrestre ; et voilà un livre qui est le résumé de tous les livres et, sans doute, l’entreprise la plus audacieuse et sublime qu’ait connue la littérature depuis ses premiers balbutiements jusqu’à nos jours. […] »

Pour le plaisir, j’ajoute ce magnifique extrait qui concerne Rimbaud :
« On raconte qu’Arthur Rimbaud, poète insolent et génial, au balcon sur une place du Quartier latin, récita pour la première fois, en soulevant l’applaudissement, ce poème mystérieux et terrible : Le Bateau ivre. Avec ses tumultes océaniques, ses passions, ses amours, et cette ligne docile et douce qui parcourt ces frénétiques strophes comme pour les apaiser et ne pas trop déferler en quête d’éclat et de tempête. Telle est la juste voie : réciter la bonne poésie sous les acclamations, la rapprocher des foules dont elle s’est éloignée. Et c’est ce que doit être la critique : signaler le chemin, non pour éviter les obstacles, mais pour les signaler, de façon à ne jamais être surpris et à pousser aux prouesses, là où la poésie et le roman ont été au plus loin, dans leur élan à atteindre avant les autres le bout de la course. Personne n’a été plus loin que les écrivains français dans la recherche de cette entité secrète qui alimente la vie et qui a pour nom littérature, la vie fictive qui est, pour beaucoup, la vraie vie, comme en cet instant suprême où Rimbaud, l’infortuné martyr de la poésie, s’est tu quand il n’avait plus rien à dire et pour ne pas tomber dans l’insuffisance ou l’artifice. […] »

Dernier livre publié : Le Tour du monde en 80 textes (ou presque), Éditions de L’Herne, 2023.


