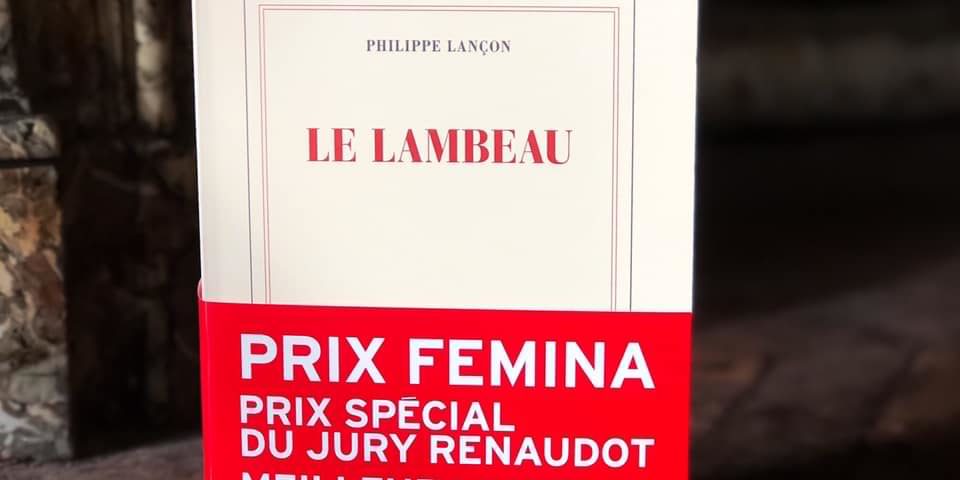Le Lambeau de Philippe Lançon, Gallimard, 2018
« Son ombre vers mon lit a paru se baisser ;
Et moi, je lui tendais les mains pour l’embrasser.
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange
D’os et de chairs meurtris, et traînés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux. »
Racine, Athalie
Prix Femina, prix spécial du jury Renaudot, prix des prix littéraires, Meilleur Livre de l’année pour la Magazine Lire… qu’a donc de si spécial Le Lambeau de Philippe lançon ?
Son livre est un récit, et non pas un roman comme l’a rappelé le jury du prix Goncourt pour justifier sa notable absence de leur sélection. Philippe Lançon y raconte l’épouvante de l’attentat de Charlie Hebdo dans les locaux du journal et la grave blessure qu’il subit, suivie de sa lente reconstruction physique et mentale.
Le 7 janvier 2015, le journaliste assiste à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo dans les locaux du journal rue Nicolas-Appert à Paris. Il est assis aux côtés de Bernard Maris, Honoré, Cabu, Charb, Tignous, Wolinski, Luz et les autres. Ils ont une discussion sur le nouveau livre de Houellebecq, Soumission, que Lançon s’entête à défendre contre tous :
« Un parfum s’en dégageait, un parfum qui correspondait à l’époque. C’était lui, Houellebecq, cette icône pop, qui le répandait avec son talent de narrateur et son efficace ambiguïté. Il avait su donner forme aux paniques contemporaines. »
Lançon raconte les minutes de l’attentat en donnant uniquement ce qu’il a pu voir et ressentir, éventuellement rectifié par ce qu’il a appris ensuite. Une fois les assassins sortis, il est couché à terre et sait qu’il est gravement blessé, couché entre les morts :
« Les morts se tenaient presque par la main. Le pied de l’un touchait le ventre de l’autre, dont les doigts effleuraient le visage du troisième, qui penchait vers la hanche du quatrième, qui semblait regarder le plafond, et tous, comme jamais et pour toujours, devinrent dans cette disposition mes compagnons… une version inédite et noire de La Danse de Matisse. »
 Henri Matisse, La Danse ; 1909-1910. Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg
Henri Matisse, La Danse ; 1909-1910. Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg
Dans le reflet de son téléphone, il découvre sa blessure au visage, « un cratère de chair détruite et pendante », avec un reste de gencive et de denture mis à nu, dont la vision lui paraît monstrueuse.
Sa lente reconstruction, physique et mentale, se fera à la fois par la chirurgie et par l’art, pour soigner en même temps son corps et son esprit.
Inutile d’y chercher ses pensées sur l’Islam et la politique, l’écrivain préfère raconter le chemin de sa guérison : la musique – Bach -, la peinture et surtout la littérature lui deviennent thérapie, en commençant par la phrase de Pascal : « Tout le malheur des hommes vient de ce qu’ils ne savent pas rester en repos dans une chambre. »
Il s’appuie principalement sur ce qu’il appelle ses « trois miroirs déformants et informants » :
- le roman de Thomas Mann, La Montagne magique
- Franz Kafka – surtout ses Lettres à Milena -, qui lui apporte « une forme de modestie et de soumission ironique à l’angoisse. »
- Et Proust, bien sûr :
« un auteur que j’avais lu avec passion, à la fois comme une sorte de bible et comme un intense divertissement, à plusieurs époques de ma vie. Je pouvais entrer dans la Recherche à n’importe quel endroit, n’importe quand, comme dans un château où j’aurais grandi, pour retrouver des personnages que je connaissais mieux que la plupart de mes amis, puisque Proust me les avait dévoilés peu à peu dans leur solitude et leurs moindres replis, comme si nous étions tous morts, lui, eux et moi, tous morts, tous humains et tous un peu divins. »
Il croit rencontrer le Docteur Cottard réincarné dans un de ses médecins ; une petite phrase dite par François Hollande en visite lui devient aussi chère que la sonate de Vinteuil au narrateur de la Recherche.
Il relit la scène de la mort de la grand-mère à chaque fois qu’on l’emmène au bloc, comme une prière préopératoire. Et s’exaspère parfois du pessimisme de Proust, de sa vision de l’amitié opposée à une solitude régénératrice, et de certaines de ses réflexions sur la mémoire :
« Je ne vivais ni le temps perdu, ni le temps retrouvé ; je vivais le temps interrompu. ».
Philippe Lançon est, lui aussi, un grand écrivain ; et ses phrases lui permettent, telles des formules magiques, de survoler encore la scène, de parler à ses amis disparus, passant de la prière aux morts à un livre :
« Je ne voulais pas que les morts s’endorment et je ne voulais pas m’endormir sans eux. »
Hélène Montjean